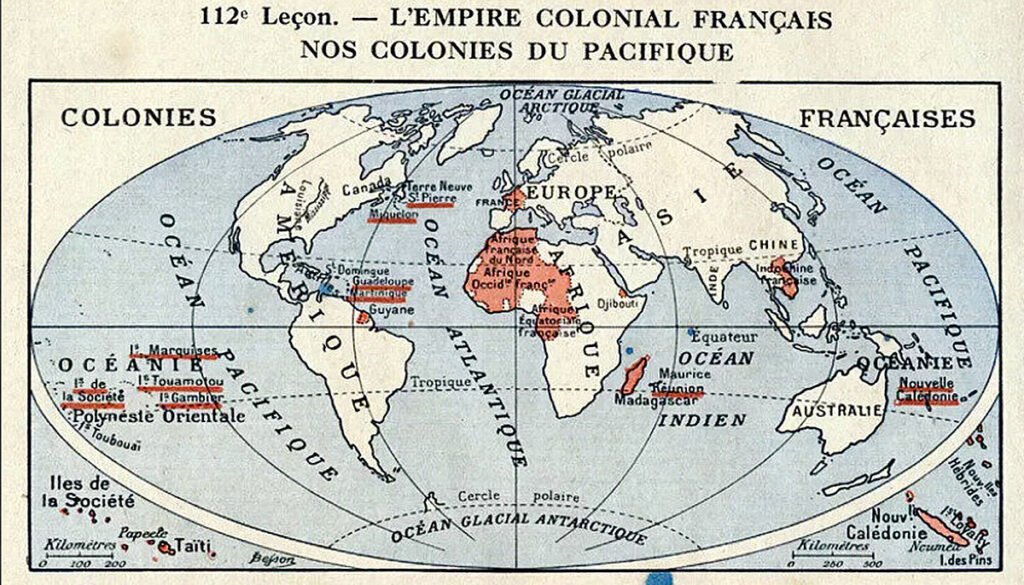
Par André Boyer
Son blog : http://andreboyer.over-blog.com/
Suite de La politique coloniale de la France (Partie 1)
Jules Ferry en arrive alors à la question clé, qui justifie à ses yeux définitivement l’expansion coloniale, la politique de puissance qui permettra à la France d’exercer une forte influence en Europe et dans le monde, une politique qui conduira inévitablement à la guerre avec les rivaux que l’on a suscités, comme le lui fait remarquer M. Paul de Cassagnac.
M. Jules Ferry : Voilà ce que j’ai à répondre à l’honorable M. Pelletan sur le second point qu’il a touché.
Il est ensuite arrivé à un troisième, plus délicat, plus grave, et sur lequel je vous demande la permission de m’expliquer en toute franchise. C’est le côté politique de la question.
[…]
Messieurs, dans l’Europe telle qu’elle est faite, dans cette concurrence de tant de rivaux que nous voyons grandir autour de nous, les uns par les perfectionnements militaires ou maritimes, les autres par le développement prodigieux d’une population incessamment croissante ; dans une Europe, ou plutôt dans un univers ainsi fait, la politique de recueillement ou d’abstention, c’est tout simplement le grand chemin de la décadence !
Les nations, au temps où nous sommes, ne sont grandes que par l’activité qu’elles développent ; ce n’est pas « par le rayonnement des institutions »… (Interruptions à gauche el à droite) qu’elles sont grandes, à l’heure qu’il est.
M. Paul de Cassagnac : Nous nous en souviendrons, c’est l’apologie de la guerre !
M. de Baudry d’Asson : Très bien ! la République, c’est la guerre. Nous ferons imprimer votre discours à nos frais et nous le répandrons dans toutes les communes de nos circonscriptions.
M. Jules Ferry : Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, en se tenant à l’écart de toutes les combinaisons européennes, en regardant comme un piège, comme une aventure, toute expansion vers l’Afrique ou vers l’Orient, vivre de cette sorte, pour une grande nation, croyez-le bien, c’est abdiquer, et dans un temps plus court que vous ne pouvez le croire, c’est descendre du premier rang au troisième ou au quatrième. (Nouvelles interruptions sur les mêmes bancs. – Très bien ! très bien ! au centre.) Je ne puis pas, messieurs, et personne, j’imagine, ne peut envisager une pareille destinée pour notre pays.
Il faut que notre pays se mette en mesure de faire ce que font tous les autres, et, puisque la politique d’expansion coloniale est le mobile général qui emporte à l’heure qu’il est toutes les puissances européennes, il faut qu’il en prenne son parti, autrement il arrivera… oh ! pas à nous qui ne verrons pas ces choses, mais à nos fils et à nos petits-fils ! il arrivera ce qui est advenu à d’autres nations qui ont joué un très grand rôle il y a trois siècles, et qui se trouvent aujourd’hui, quelque puissantes, quelque grandes qu’elles aient été descendues au troisième ou au quatrième rang. (Interruptions.)
Aujourd’hui la question est très bien posée : le rejet des crédits qui vous sont soumis, c’est la politique d’abdication proclamée et décidée. (Non ! non !) Je sais bien que vous ne la voterez pas, cette politique, je sais très bien aussi que la France vous applaudira de ne pas l’avoir votée ; le corps électoral devant lequel vous allez rendre n’est pas plus que nous partisan de la politique de l’abdication ; allez bravement devant lui, dites-lui ce que vous avez fait, ne plaidez pas les circonstances atténuantes ! (Exclamations à droite et à l’extrême gauche. – Applaudissements à gauche et au centre.) … dites que vous avez voulu une France grande en toutes choses…
Un membre : Pas par la conquête !
M. Jules Ferry : … grande par les arts de la paix, comme par la politique coloniale, dites cela au corps électoral, et il vous comprendra.
M. Raoul Duval : Le pays, vous l’avez conduit à la défaite et à la banqueroute.
M. Jules Ferry : Quant à moi, je comprends à merveille que les partis monarchiques s’indignent de voir la République française suivre une politique qui ne se renferme pas dans cet idéal de modestie, de réserve, et, si vous me permettez l’expression, de pot-au-feu… (Interruptions et rires à droite) que les représentants des monarchies déchues voudraient imposer à la France. (Applaudissements au centre.)
M. le baron Dufour : C’est un langage de maître d’hôtel que vous tenez là.
M. Paul de Cassagnac : Les électeurs préfèrent le pot-au-feu au pain que vous leur avez donné pendant le siège, sachez-le bien !
M. Jules Ferry : Je connais votre langage, j’ai lu vos journaux… Oh ! l’on ne se cache pas pour nous le dire, on ne nous le dissimule pas : les partisans des monarchies déchues estiment qu’une politique grande, ayant de la suite, qu’une politique capable de vastes desseins et de grandes pensées, est l’apanage de la monarchie, que le gouvernement démocratique, au contraire, est un gouvernement qui rabaisse toutes choses…
M. de Baudry d’Asson : C’est très vrai !
M. Jules Ferry : Eh bien, lorsque les républicains sont arrivés aux affaires, en 1879, lorsque le parti républicain a pris dans toute sa liberté le gouvernement et la responsabilité des affaires publiques, il a tenu à donner un démenti à cette lugubre prophétie, et il a montré, dans tout ce qu’il a entrepris…
M. de Saint-Martin : Le résultat en est beau !
M. Calla : Le déficit et la faillite !
M. Jules Ferry : …aussi bien dans les travaux publics et dans la construction des écoles… (Applaudissements au centre et à gauche), que dans sa politique d’extension coloniale, qu’il avait le sentiment de la grandeur de la France. (Nouveaux applaudissements au centre et à gauche.)
Il a montré qu’il comprenait bien qu’on ne pouvait pas proposer à la France un idéal politique conforme à celui de nations comme la libre Belgique et comme la Suisse républicaine, qu’il faut autre chose à la France : qu’elle ne peut pas être seulement un pays libre, qu’elle doit aussi être un grand pays exerçant sur les destinées de l’Europe toute l’influence qui lui appartient, qu’elle doit répandre cette influence sur le monde, et porter partout où elle le peut sa langue, ses moeurs, son drapeau, ses armes, son génie. (Applaudissements au centre et à gauche.)
Quand vous direz cela au pays, messieurs, comme c’est l’ensemble de cette oeuvre, comme c’est la grandeur de cette conception qu’on attaque, comme c’est toujours le même procès qu’on instruit contre vous, aussi bien quand il s’agit d’écoles et de travaux publics que quand il s’agit de politique coloniale, quand vous direz à vos électeurs : « Voilà ce que nous avons voulu faire » soyez tranquilles, vos électeurs vous entendront, et le pays sera avec vous, car la France n’a jamais tenu rigueur à ceux qui ont voulu sa grandeur matérielle, morale et intellectuelle (Bravos prolongés à gauche et au centre. – Double salve d’applaudissements – L’orateur en retournant à son banc reçoit les félicitations de ses collègues.)
Aujourd’hui, la France en est toujours, avec ses moyens, à justifier la politique qu’elle conduit par des considérations stratégiques et économiques, mais elle n’a toujours pas abandonné l’idée qu’elle disposait d’un droit moral sur les anciennes colonies françaises, suscitant au pire l’ire des Africains et au mieux leur sourire. Que la Russie ou la Chine interviennent en Afrique apparait souvent en France comme un crime de lèse-majesté : mais enfin la France est une démocratie, le pays des droits de l’homme, aller frayer avec ces pays impurs est parfaitement illégitime…
Si les diplomates et les journalistes français connaissaient vraiment l’Afrique et un peu l’histoire, ils se tairaient.


